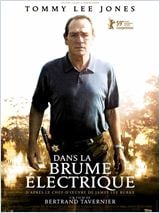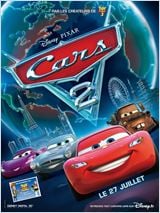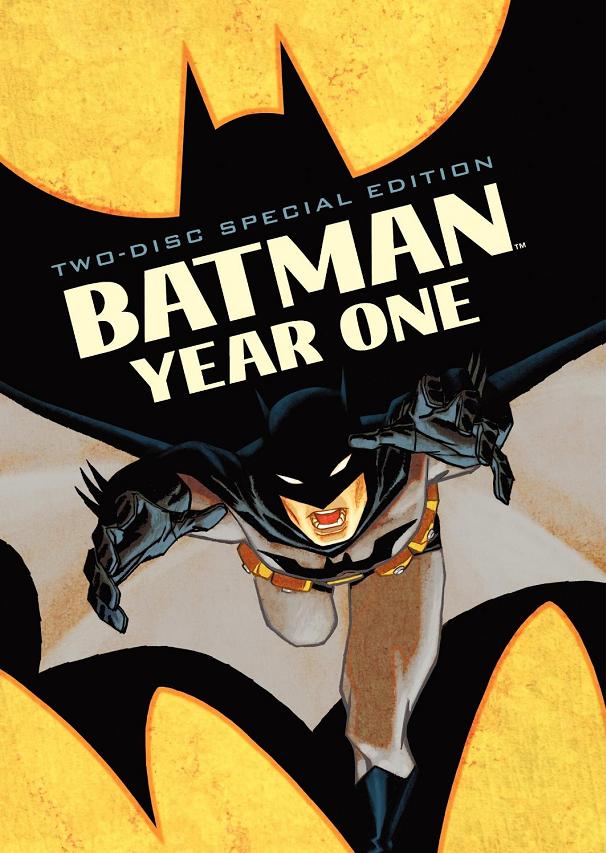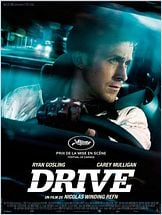Un bon blog se doit de parler du grand détournement au moins tous les deux ans. Rien n’a bougé depuis l’article de 2009
Je vous parlais du projet pharaonesque qui se lançait dans la restauration de l’oeuvre. pour des raisons de droit, le film n’est plus diffusable. Afin de permettre aux générations futures de vivre ce grand moment, un grand illuminé s’amusait à acheter tous les dvds des films utilisés pour le Grand détournement et refait le montage en image de meilleure qualité. Le projet est tellement ancien maintenant qu’il repart de plus belle avec la version issue de Blue-ray
Ce travail dépend bien entendu de la réédition en dvd ou blue-ray des films composant le patchwork. Et certains mettent très très très longtemps à réapparaître.Sans compter que Sam Hocevar (qui gère le projet en plus de ces nombreuses activités notamment VLC) pousse la finition jusqu’aux polices de caractères utilisées en incrustation, jusqu’à retailler les images et refaire les filtres.
Bon tout ça pour dire que je pensais que le projet n’avait pas évolué depuis longtemps ce qui était un peu le cas. J’avais récupéré la version finalisée à 99% et point final. Mais il restait quand même un vieux loup de mer dans ce projet : il n’avait jamais pu trouver l’origine d’une scène toute con à savoir une horloge murale. C’était là l’objet d’une angoisse sans fin. Cette horloge avait fini par devenir un mythe dans la grande légende de ce film.
Et bien j’avais un train de retard. Le mystère est résolu depuis mars 2011. Elle apparaît dans un épisode de Maigret : “Maigret et les plaisirs de la Nuit”. c’est encore un des grands mystères de l’humanité qui trouve ici son dénouement.
Pourquoi je reparle de tout ça? A cause d’un article de Numérama parlant de sa disparition dur Dailymotion.
Quant à la restauration elle poursuit sa vie sur ce site : CYCLIMS.